Couverture du Dernier stade de la soif, dans l’édition de Monsieur Toussaint Louverture, 2018, trad. Philippe Aronson et Jérôme Schmidt.
C’est une des lectures qui m’ont le plus marqué ces dernières années. Une expérience de lecture comparable à celle du Voyage au bout de la nuit ou du Diable tout le temps de Pollock, où page après page, on souligne des phrases et coche des paragraphes pour plus tard, parce qu’ils ont quelque chose de l’exploit, parce qu’on se dit qu’à y revenir ils nous augmenteront. L’auteur semble avoir été assez peu lu en France. Un peu de vagabondage internaute révèle une excellente donation à la bibliothèque de l’Université de Rochester – une honnête ville de l’État de New York, siège historique de Kodak, où j’ai, pré-adolescent, joué au base-ball – dont la notice de fond est tout à fait exemplaire d’une bonne notice de fond littéraire1.
Les deux principaux thèmes du livre, le sport (et à travers lui le père) et l’alcoolisme, qui ont produit respectivement les titres original (A Fan’s notes) et français (Le Dernier stade de la soif), m’ont laissé (comparativement) indifférent. Le travail de la confession, dont l’intensité et le courage impudique ont tant frappé Nick Horny dans sa postface2, m’a ici et là noué les tripes, à l’instar de ce passage où Freddy se souvient d’une stratégie mesquine d’agression du compagnon de sa mère
« C’est alors que j’ajoutai un véritable coup de maître à mes faits d’armes : je feignis d’avoir peur de lui. Avant d’entrer dans une pièce, je passais mon visage mal rasé par l’embrasure de la porte, scrutant alentour, et s’il était là, je retirais ma tête, l’air apeuré, comme si sa présence constituait un danger indicible. Une ou deux fois, je l’entendis demander à ma mère : « c’est quoi, ce cirque ? » Et je gloussais dans mon coin. Mais ce rire n’était en aucun cas synonyme de victoire. Lorsqu’il posait cette question, sa voix était empreinte d’un amusement perplexe plus que de colère. (…) Car c’était un sacré type, pas du genre à se laisser avoir par des jeux idiots et infantiles. Pire encore – oh, l’incroyable et insidieuse tristesse de la maladie – j’étais toujours le bienvenu chez lui. »3
Ou dans cet aveu de la totale insensibilité paternelle, la feinte des gestes obligés du jeune père découlant d’un impératif de sécurité matérielle de l’écrivain :
Comme le livre avançait à une vitesse démoniaque, mon but principal – il en va toujours ainsi chez les psychopathes – était de me protéger jusqu’à la fin de son écriture, et, pour y arriver je devais faire comprendre à Prudence [sa femme] que je n’étais pas un monstre, afin d’éviter de me retrouver à la rue, bagages et manuscrits à la main. Parfaitement rompu à ce petit jeu, je jouais mon rôle et restais de bonne composition en toute circonstances (…). Prenant mes fils sur les genoux, je les embrassais sans cesse. (…) jamais hélas leur chaleur ne me pénétra. Ils auraient aussi bien pu être des poupées de chiffon. »4
Le placement du curseur entre autofiction et autobiographie5, l’évaluation de l’importante part biographique de cette fiction, pourront bien occuper des critiques. Exley était-il un salaud malade ? C’est sans importance.
C’est tout le reste qui m’a embarqué, comme embarque un conte de randonnée à la première personne, qui nous transporte de station en station, de personnage en personnage, dans un voyage en humanité, un voyage clairvoyant mais ludique, chirurgical et sympathique, aussi fantastique que sociologique. Le Graal serait, ici quelque chose comme la rédemption, ou plutôt – transposition moderne du courage chevaleresque – la distillation d’un cynisme mortifère en humour romanesque, avec six majuscules à humour.
Allégories, galerie, anti-héros
Le premier plaisir (littéraire) que le lecteur du Dernier stade prend, c’est la rencontre des autres. Ces Paddy the Duke, Mister Blue, L’avocat, USS Deborah, Bunny Sue et autres Bumpy surgissent, sans qu’on sache réellement d’où ils viennent. On en découvre, en quelques lignes bien stylisées, le cadre de vie. On les accompagne dans leurs tribulations avec Freddy. Puis on les congédie. Entretemps ils nous ont dessiné une formidable galerie caricaturale de l’Amérique, de NYC, à Chicago, en passant par l’asile d’Avalon Valley. Ces personnages incroyables
- font penser aux vilains et adjuvants des Comic Books : ils sont des figures mémorables, mues par des émotions et leur histoire propre, capables d’infléchir un peu la trajectoire du héros, mais ils disparaissent;
- appartiennent à cette catégorie de l’épistémologie médiévale : les merveilles (mirabilia)6 ;
- partagent une formidable charge allégorique, qui les rapproche de Guignol ou de la Commedia dell Arte, l’allégorie partagée étant celle de l’Amérique, à la fois le pays (tout court) et le pays qui rend fou.
[première et dernière liste à puces snob de cet article]
Freddy ne les connait pas vraiment. Mais il expérimente avec eux des liens d’une nature nouvelle. Au travers de la passion amoureuse comme de la camaraderie d’asile, de beuverie ou de route, il noue avec eux des liens faibles d’une grande puissance. Alors nous aussi. Parce que nous nous attachons à Freddy, non seulement en raison du pacte7, mais parce qu’il est brillant (le narrateur, pas le personnage), nous nous attachons à cette Amérique, à sa folie, à ses marginaux. Chacun y est marqué par quelques immenses difformités morales et sociales, des attributs (le salto arrière, la littérature sexologique hygiéniste, le ping pong, la boulimie dans un basement-bunker de sandwiches au fromage…), des espèces de manies et tares grotesques, qu’ils transcendent, et dont l’approfondissement jouissif et inquiétant nous approche de quelque chose d’intemporel. Dans la charge ils conservent un formidable noyau d’humanité. Jusque dans leur mort, à la lisière du magique et de l’ordinaire, cs anti-héros magnifiques ont un pied dans ce que les micro-historiens, après Grendi, nomment l’ « exceptionnel normal », et un autre dans le réalisme magique latino-américain. Si nous ne saviez pas que le Père Noël, terrifié par l’idée du cunnilingus, est mort au milieu des séraphins dans ses toilettes, où il fumait en cachette de sa femme, d’une explosion de crème à raser, lisez le Dernier stade de la soif8.
Des lieux de l’Amérique
Dans les romans arthuriens, et dans la littérature médiévale en général, les histoires des héros se déroulent dans un espace systématique, opposant lieux de l’intérieur (de la civilisation) et lieux de l’extérieur (des périls et de la quête). On passe de la cour aux vallons, tertres, ermitages, forêts, puis on revient au banquet, à la chambre ou au jardin clôs. Freddy, anti-héros magnifique, évolue aussi dans un imaginaire spatial (de l’Amérique), dont les lieux génériques et parsemés dans le roman sont les maisons, les bars, les stades, les voitures et les émissions de télévision, et que structurent deux pôles stables vers lesquels faire retour : le canapé, d’abord (qui dresse un pont tacite entre Céline et la psychanalyse), et cet équivalent US du monastère : l’asile de fous, qu’on a évoqué plus haut. Tout au long de la lecture, le lecteur se demande si Exley a lu Michel Foucault ou Céline, avant de renvoyer ce questionnement insipide dans les limbes de l’analyse érudite dérisoire9. Voici la maison des Allorgee, éphémère belle-famille, caricature du rêve américain de la middle class du midwest (dont la description permet, comme en passant, de se payer à nouveau les communications modernes) :
« Les Allorgee vivaient dans une banlieue de banlieue, un petit îlot du nom de Heritage Heights. Apparemment, cet endroit n’avait jamais réussi à attirer les foules. Il y avait plusieurs rues, mais une seule maison, la propriété des Allorgee, un grand pavillon blanc aux allures de ranch organisé comme les rayons d’une gigantesque roue, avec garage, salle de jeux et chauffe-eau massés au même étage. Malgré son nom, le lieu n’avait pas de hauteur, c’était une construction du Middle West des plus grotesques, aride et sans aucun arbre à perte de vue. Une seule chose venait briser la monotonie du ciel bleu : une antenne de télévision qui se dressait si haut dans le ciel que la regarder donnait le tournis, une antenne qui, m’informa-t-on fièrement, permettait aux Allorgee, les jours de beau-temps, d’entrer en contact avec toutes les autres régions du pays. C’était un émouvant monument en hommage à leur isolement. Quand je l’interrogeai sur sa taille démesurée, Chuck (ou Popi) – comme le père était indifféremment appelé – se contenta de me répondre qu’il aimait avoir une bonne réception. C’est la seule phrase que je me souviens avoir entendue dans la bouche de Chuck, ou Popi, de tout le week-end. »10
Voici la cuisine des feuilletons télévisés :
« Il serait faux de dire que je ne prenais aucun plaisir à regarder la télévision. Le monde passionnant des feuilletons me captivait totalement. Je ne me souviens plus de leurs noms, ni de leurs intrigues, si ce n’est que l’action se déroulait avec une angoissante lenteur subaquatique. L’image qu’ils donnaient de l’Amérique était plus juste que ne pouvaient l’imaginer leurs scénaristes goguenards ou leurs acteurs empotés (ces derniers incarnaient gauchement leurs rôles, comme pour nous signifier qu’ils ne faisaient ça qu’entre deux pièces de théâtre). (…) Sans me souvenir des intrigues, je me rappelle une scène récurrente dans laquelle, telles des sorcières de MacBeth autour du chaudron, ces femmes se rassemblaient dans de jolies cuisines luisantes dotées de rideaux en mousseline et de fours en brique beige ; là assises autour de tables d’une blancheur de porcelaine, recouvertes d’exquises petites tassés à café et de fleurs artificielles, elles prévoyaient, complotaient et critiquaient tous les personnages fantomatiques et inexistants qui entraient et sortaient de la pièce. Le scénariste, dans son cynisme, et pour deux mille dollars la semaine, les laissait ainsi manigancer, leur fourguant des répliques idiotes qu’il trouvait pertinentes. »11
Violence de la folie, éloge de la folie
Le personnage de Freddy agit tantôt en fou du roi (le roi, c’est nous), en bouffon (fou en apparence, sage dans la subversion, cynique par nécessité), tantôt en malade. Cette ambivalence évite souvent au roman de tomber dans le pathos angoissant d’une pure descente aux enfers. Et puis, bien sûr, selon un thème très 70’s, il apparait assez rapidement que tout le monde en réalité est fou, que le monde est fou, que le pire fou n’est pas qui l’on croit, etc. Voici ce journaliste anglais, croisé le temps de quatre pages à peine, qui démissionne de rédaction locale en rédaction locale, quand, lassé des articles de circonstance sans intérêt, il cède à l’impérieux appel de l’article parodique et à la pression du fou rire cynique, « pour ne pas sombrer dans la folie. »12
Certes, on évite le pathos, on jouit de la farce, on applaudit souvent aux lucidités désinhibées et un peu chevaleresques de notre Freddy, par exemple quand il est à deux doigts, se faisant passer pour un avocat, de convaincre la sœur d’un interné d’Avallon de venir une fois de plus en aide à son frère mythomane et instable, mais qu’il se heurte au beau-frère, sorte de dragon petit bourgeois, gardien de l’ordre (de la famille et du monde), se payant une fois de plus, au passage, les communications modernes (autrement dit : de l’utopie contemporaine par excellence13) :
« De l’argent ? dis-je. Me coûter de l’argent ? Espèce d’enculé ! Je parle de la vie d’un homme ! Tu sais ce que c’est ? » A l’autre bout du fil, George hoquetait, comme atteint d’une crise d’emphysème et – bien malgré moi – j’éclatai de rire. Finalement, je l’avais coincé. Reprenant son souffle, dans un effort parfaitement audible, il hurla à sa femme de raccrocher, comme si elle n’était pas prête à entendre de telles obscénités – ce qui me fit rire de plus belle, et encore plus bêtement. Ce qu’il voulait, c’était bien évidemment lui masquer la vérité à son sujet, et ce qu’il ne semblait pas comprendre, c’était que ses pleurs signifiaient qu’elle la connaissait déjà. (…) « Va te faire foutre, conclus-je en mettant fin à la conversation. » Je restai longtemps assis dans la cabine, la main toujours agrippée au téléphone. L’opératrice se manifesta et me demanda de payer quatre dollars pour le dépassement. Je refusai. Sur un ton détaché : « Non, je ne le ferai pas. » Incrédule comme seuls les automates peuvent l’être quand le système s’écroule, elle s’exclama d’une vois tremblante d’indignation : « Mais Monsieur, vous avez passé ce coup de fil ! -Ouais, je sais. Mais je n’en ai pas eu pour mon argent. »14
Mais si la folie sociale et culturelle est partout, elle est par endroits concrète, incarnée, clinique. Elle a ses conséquences particulières (Freddy fait souffrir et souffre) et ses institutions générales. Les pages consacrées à l’asile, à Avallon Valley, sont fascinantes, parfois très drôles, parfois difficiles à lire. C’est le Dernier stade de la soif qui m’a appris l’histoire thérapeutique du choc insulinique15. La description de l’aliénation physique et morale qu’installe la cure de Sakel est ignoble. Pouvoir, tout en l’ayant lue, dire du Dernier stade de la soif qu’il est un roman épique, jouissif et drôle donne une idée de la richesse de l’œuvre.
- The Frederick Exley collection consists of 36 boxes and 9 oversize items of Exley’s personal papers and memorabilia, including 7 boxes of correspondence; 6 boxes of manuscript and printed material by Exley; 1 box of manuscript material by other writers; 4 boxes of printed material and ephemera; 2 boxes of financial, legal, medical and personal documents and materials; 5 boxes of ephemera and memorabilia; 7 boxes of Jonathan Yardley’s personal research and manuscript material; 5 packages of oversize ephemera; 1 framed oil portrait; and 3 large exhibit posterboard photos. Most of the collection consists of materials relating to Exley’s career as a writer and his personal life during those years, as he did not save much from his childhood or his life in general before writing A Fan’s Notes. ↩︎
- « si bien que parfois, on lit Le dernier stade de la soif du bout des doigts, horrifié, mais fasciné. ». Op. cit., p. 505. ↩︎
- Op. cit. , p. 302. ↩︎
- Op.cit., p. 437. ↩︎
- « Même si les événements décrits dans ce livre ressemblent à ceux qui constituent le long malaise qu’est ma vie, l’essentiel des personnages et des situations est le fruit de mon imagination. » (Note à l’attention du lecteur, . p15). Je me souviens avoir volontairement, c’est-à-dire consciemment, repoussé plusieurs fois la question de lecture : « c’est vrai ou inventé ? ». ↩︎
- Dignes d’être regardées, les licornes, les éléphants, les griffons et phénix, les anguilles à pieds terrestres de l’Inde, l’arbre du Soleil et de la Lune qui annonce l’avenir, existent certainement puisque Pline, les encyclopédies et les livres de la légende du grand Alexandre en parlent (mais on ne les a quand même pas vus, et même si les livres antiques sont supérieurs parce qu’antérieurs, autorisés et écrits, cela nous empêche de les mettre tout à fait sur le même plan (y compris de vérité) que ce qui nous entoure. ↩︎
- Je ne sais pas quel sort l’autofiction fait au pacte autobiographique. En vacances, je compte demeurer dans cette ignorance. Mais l’attitude d’ignorance volontaire que j’ai adoptée (note 3) relève peut-être d’un pacte. . ↩︎
- Op. cit., p. 394. ↩︎
- Mais l’auteur étant érudit lui-même (et professeur de lettres), le texte est truffé de clins d’œils possibles. Christie III, le chien qui garde le canapé du domicile maternel, et qui reste durant une longue période de dépression et d’absorption dans la télévision (la mort) le seul lien entre Freddy et la vie, est-il le Christ ou Cerbère ? ↩︎
- Op. cit., p. 232 ↩︎
- Op. cit., p. 277 ↩︎
- Op.cit., 388. ↩︎
- Une autre des grandes lectures de ma vie d’adute a été Armand Mattelart, Histoire de l’utopie planétaire : de la cité prophétique à la société globale, 1999. ↩︎
- Op. cit., p. 328. ↩︎
- Op. cit., p. 128. ↩︎

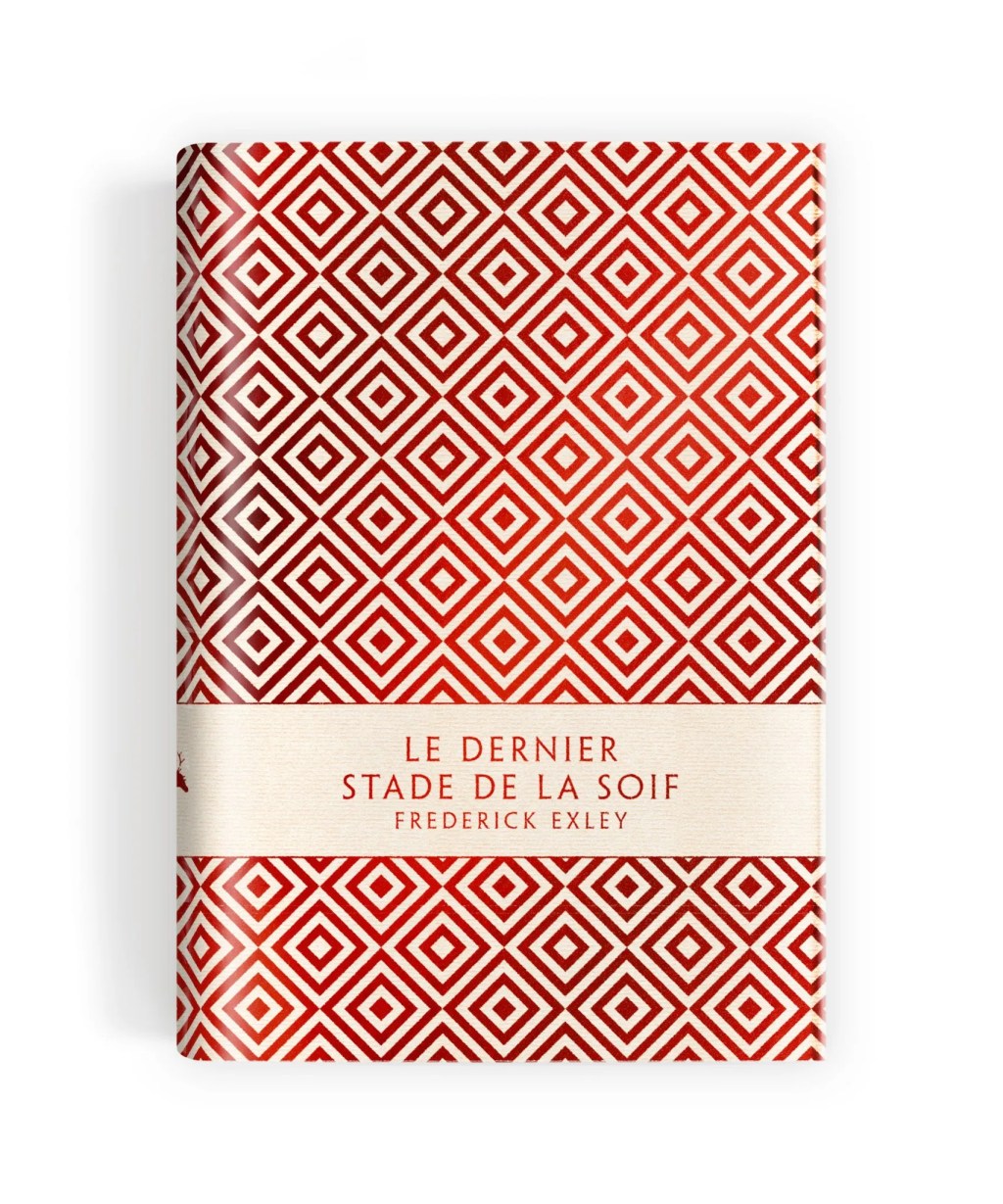
Laisser un commentaire