Photographie de la verrière du Polygone, sous laquelle apparait une installation de l’artiste japonaise Tsuyu Bridwell.
Je suis trop couvert. Il y a du monde. J’attends des proches. Assis sur un banc sans dossier, je résiste mal à la tentation de mon téléphone. Je sortirais bien mon carnet, mais encombré par les deux ou trois sacs qu’on m’a confiés, peu vaillant, je me sens lourd. Je relève la tête, m’étire, et vois la chose. J’éprouve le sentiment paradoxal qu’elle est parfaitement conformiste (volontairement conforme à notre système de valeurs) et très triste, et c’est ce sentiment (et non le dispositif à prétention artistique qui le cause à son insu) qui m’irrite – et me pousse à la photo documentaire. La vague déambulation qui s’ensuit, transcrite ci-dessous, est-elle une forme de réaction inflammatoire ?
Pas même dérisoire : un attrape-rêves à la verticale d’un songe mauvais ?
A première vue, rien que de très cohérent sous la verrière : un centre commercial a une fonction hallucinatoire, comme un casino, comme un scroll de vidéos dopaminées, comme un jeu vidéo dont les feed-back sont instantanés et fortement décorrélés de l’effort, comme le ronron de mon chat, comme un bouillon de noodles sur-pimentées, comme tous les dispositifs distractifs de masse face auxquels un moine, un stoïque, un caillou ne font pas le poids (moral). Cette fonction s’articule avec le mode désincarné de la consommation dans l’économie moderne, que décrit l’historien Anthony Galuzzo :
La marchandise se trouve recouverte par un halo d’ignorance : le consommateur, aveugle à la production, est bien incapable de jauger les coûts, les constituants du produit, la somme des efforts et des souffrances qu’a nécessité sa fabrication. L’homme moderne ne peut plus appréhender le produit que sur un mode halluciné : l’objet semble exister par lui-même, indépendant de tout le maillage social qui lui a donné naissance. Il se donne à voir sur les linéaires des magasins tel un pur plaisir et une pure matière contemplative. Il participe magiquement à la fantasmagorie, au rêve éveillé du consommateur-contemplateur (…) Dans ce contexte, de nouvelles institutions totalisantes, les grands magasins, vont développer les techniques fondamentales d’un rapport sensuel à la marchandise. Ces magasins vont scénographier l’abondance, préparer le rêve éveillé et exciter les désirs.1.
L’œuvre serait-elle à prendre au second degré ? Sur le marché de l’art contemporain, la démarche transgressive apparait comme une condition esthétique et commerciale de la valeur. Un attrape-rêves surplombant un mauvais rêve éveillé (ou, selon votre sensibilité ou le jour de la semaine, un cauchemar assommant), ça pourrait être un peu comme un Jeff Koons à Versailles ou une image pédophile dans une exposition sur l’enfance : un genre de mascarade pseudo-polémique, assumée et facile à marketer. Sauf que ces cerceaux faiblards à l’étage le moins fréquenté du bazar ne risquent de choquer personne, sinon quelques irritables désœuvrés, dont je suis ce jour-là.
De quoi l’attrape-rêves est-il le nom ?
Des irritants de ce genre, on en croise tous les jours, qui risquent de nous mettre dans la posture du grincheux pas content. Autant les transformer en étincelles documentaires ! Après tout, c’est quoi, un « capteur de rêves » ou dreamcatcher ? Clairement le mot est un « concept » (comme on disait en l’an 2000). C’est fou, le nombre de marques, noms de société, titres de tout et rien, qui attrapent des (mauvais) rêves. Se côtoient allègrement un parfum, une agence événementielle, un livre jeunesse, un groupe de metal français imitant les Inconnus et une band de pop coréenne féminine plus ou moins amatrice d’histoire de l’art, des photographes spécialisés dans l’accompagnement péri-natal qui nous proposent « de créer ensemble des souvenirs, des racines pour votre famille » (ce qui indique qu’il n’y a pas que les centres commerciaux qui osent tout : « moi, ce que j’aime, le matin, c’est me créer une racine », « vas-y comme je me pousse », etc.) Que dire des kits de coloriage, du DIY, de la déco…
La légende de Nokomis
Trève de concept, revenons à la source. Le capteur de rêves est un objet de la culture ojibwa. Les Ojibwa sont une nation autochtone de la famille des Algonquins (l’une des trois grandes familles, avec les Iroquoiens et les Inuits), originellement une nation nomade, de trappeurs et commerçants de fourrures, principalement implantés dans les territoires actuels de l’Ontario et du Manitoba (Canada), du Minnesota et du Dakota (USA). Les Ojibwa ont vaincu, il y a très longtemps, les Sioux. D’ailleurs, le mot « sioux » viendrait du mot désignant l’ennemi en langue ojibwa (les Sioux s’appelant eux-même les Dakota). Le lecteur attentif aura inféré que si les Ojibwa sont présents au Dakota, c’est qu’ils ont délogé les Sioux. Si bien que les Dakota (les Sioux, quoi) sont la seconde nation à connaître le capteur de rêves.
Dans la culture ojibwa, donc, la toile du capteur de rêves est expliquée par les variations mythiques d’un récit dont on retrouve une version simple et mille fois dupliquée sur le… web (sic) : une araignée tissait tranquillement à côté de Nokomis, une grand-mère, qui tissait également. L’enfant du foyer arrive et veut l’écraser. La grand-mère l’en empêche. En signe de gratitude, l’araignée apprend à la grand-mère à tisser le capteur de rêves, qui protègera les enfants de la famille des mauvais rêves (en les emprisonnant dans la perle centrale, afin qu’ils soient brulés le lendemain par les rayons du soleil) et en laissant circuler les bons (dans la lacune de la toile). La toile du capteur est tissée à partir de huit points du cercle – le nombre de pattes de l’araignée. Des plumes ornent la partie inférieure du cercle. Il est probable que les Ojibwa dorment et rêvent bien – ce qui correspond certainement à une activité sans rapport avec ce que nous nommons dormir et rêver. Ce qui me rappelle une lecture d’étudiant :
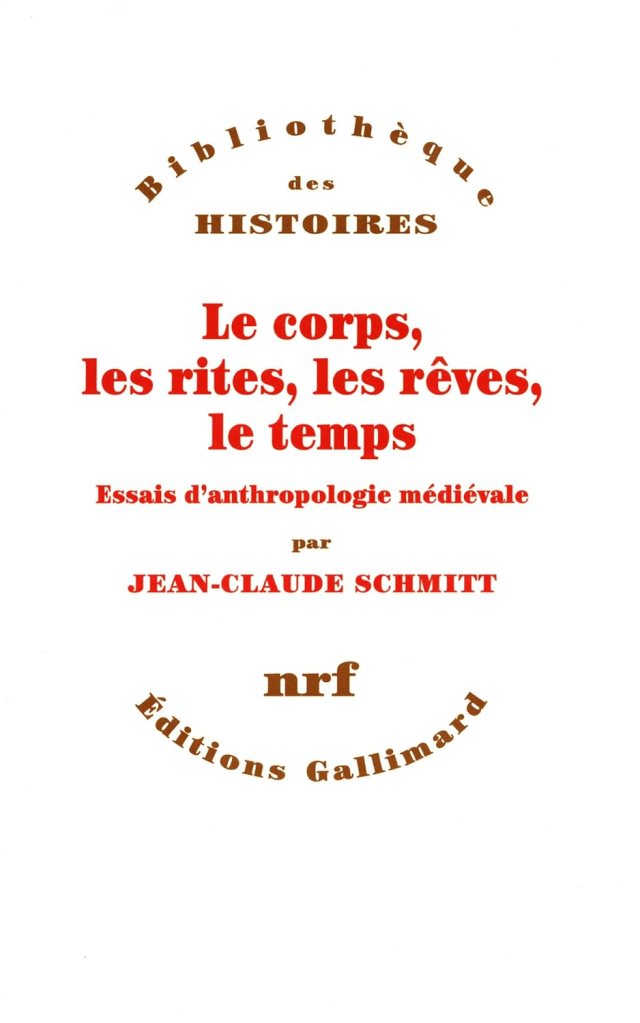
Un symbole panamérindien ?
Dans les années 70, l’exode rural conduit un grand nombre d’autochtones issus de communautés, cultures et langues différentes à rejoindre des espaces péri-urbains, où ils alimentent un nouveau prolétariat. En lisière des villes se tiennent des pow-wows : à la fois marchés, lieux de trocs, et espaces de cérémonies rituelles, ces grands regroupements forment un creuset de syncrétisme : une identité culturelle pan-indienne, transversale à l’Amérique du Nord, se constitue. Le capteur de rêves des anciens trappeurs objiwa se diffuse. Au même moment, le mouvement du Red Power donne un débouché politique au pan-indianisme au travers de l’American Indian Mouvement. Ses leaders sont majoritairement issus des Ojibwa, à l’instar de Denis Banks et Clyde Bellecourt. On est vers 1968-1969. Minneapolis est le foyer contestataire. 89 indiens, majoritairement des Ojibwe, occupent l’île d’Alcatraz, dont la légendaire prison a été fermée. C’est un peu le Larzac des peaux-rouges, et le showbiz, notamment Creedence Clearwater Revival, soutient le mouvement. A Woodstock, Jimi Hendrix porte un habit à franges de plumes. Sur cette séquence (comme on dit de nos jours), cette divagation m’a fait découvrir une excellente exposition numérique du musée universitaire Muscarelle en Virginie. Merci le Polygone !
Autre fun fact : le symbole qui orne le drapeau de l’AIM, graphiquement très réussi, est inspiré d’un autre motif circulaire, celui de la roue de médecine.

L’AIM revendique la préservation des identités culturelles, ce que documente de façon très vivante une émission de radio consacrée aux survival schools (écoles pan-amérindiennes) du Minnesota. Restaurée par la Library of Congress, l’émission est en ligne ici.
C’est dans ce contexte et à cette époque que le capteur de rêves s’est répandu dans toutes les ethnies amérindiennes.
En revanche, il est tout à fait frappant, sinon historiquement consternant, que ni l’objet ni le symbole n’ont l’air d’avoir franchement irrigué la culture baba-cool. Si vous n’avez rien à faire, voici une occupation utile et chronophage : traquer, via les bases d’images et d’archives en ligne, la présence du capteur de rêve dans l’iconographie hippie. J’ai fait chou blanc, en creusant pourtant du côté des Grateful Dead (très sensibles aux cultures amérindiennes), et de l’iconographie de Woodstock. Dont acte. J’ai en revanche découvert sur le site de Standford les très belles photographies documentaires de Bob Fitch, notamment la série Hippie is Necessary (1967). Pas de dreamcatcher, mais du mandala. D’où l’hypothèse : chez le hippie, l’indien précède l’amérindien.
Politique, business et appropriation culturelle
C’est donc plus tard, vers 1985-1995, années de mon enfance innocente, que le dreamcatcher a atteint son statut d’objet néo-traditionnel et pseudo-mystique à commercialisation de masse. Il en a toutes les caractéristiques morales et matérielles.
« As a marketable item, dream catchers meet the accepted requirements of
souvenir art: small, portable and non-perishable, as well as being hand-crafted
and sold at reasonable prices (…). In addition, they are considered functional, for they can be worn, used as ornaments or serve as a potential source of well-being; protect a vehicle operator; shield computers from viruses; filter messages; and validate a traveller’s trip. Their exoticism as material reminders of « the other » renders them desirable as gifts; moreover, dream catchers tangibly signify and project (at least to the non-Native audience) the collector’s empathy and a presumed understanding of Native culture2. »
Un mémoire de maîtrise soutenu à l’Université de Québec, par une certaine Marie Serre, a par exemple essayé de retracer l’importation de cet artefact au sein de la communauté huronne de Wendake, près de Québec, et souligne combien les artisans interviewés divergent sur leur compréhension de l’origine de l’objet, mais convergent sur l’opportunité d’en produire et d’en vendre3.
La fonction même du dispositif, attraper des rêves, saisie hors de son contexte anthropologique, ne pouvait que faire écho à une culture occidentale fortement travaillée par la psychanalyse. Une appréhension superficielle de l’anthropologie du rêve dans les sociétés indiennes (les rêves y sont des entités externes, comme des esprits) a sans doute pu séduire les amateurs d’ésotérisme de tout poil, tendance new age, Esalen, et compagnie. En tout cas, le business a fonctionné et cette appropriation culturelle n’a pas été trop mal vécue, car
« there is a general consensus among the Ojibwa that it is all right for others to use and sell the dreamcatcher as long as it is done correctly and with respect »4
On trouve sur le web des avis contraires : « dreamcatchers are not your aesthetic » dit un site indigéniste. Cette notion de correction, d’usage correct, porte notamment sur la taille, la forme et le lieu de destination du capteur. Ainsi, d’aucuns ont pu s’agacer de la mode du dreamcatcher attaché au rétroviseur central de l’habitacle. Quid des grandes breloques du centre commercial ?
Retour au Polygone, choc des anecdotes
Il y a dix ans j’ai offert un capteur de rêves (je disais, comme tout le monde en France, « attrape-rêves ») à une enfant, qui l’a conservé, et qui l’a encore dans sa chambre. Il est très possible que ce capteur de rêves ait fonctionné, et fonctionne encore. Parce que si aucun objet technique n’est génériquement neutre – une poignée de porte, selon l’exemple canonique, est une invitation à ouvrir une porte -, tout objet singulier porte au cœur la trace de son contexte, et règle son devenir sur ce qu’on en fait. Pour le dire autrement : bah c’est pas pareil.
Et si j’en veux à l’accrochage plaqué de la verrière du polygone, c’est aussi parce que j’ai cette impression indéfinissable qu’il pourrait entacher, un peu, le cadeau que j’ai fait. Mais les deux ou trois heures de lectures diverses, rapides et déstructurées qui ont présidé à ce billet ont réparé l’offense. Et l’enfant, aujourd’hui une jeune adulte, continuera certainement de faire de beaux rêves.
De cette histoire découlent 1.une morale très pragmatique et 2.un problème très théorique :
- 1.la prochaine fois que j’accompagnerai des proches faire les soldes, je porterai des vêtements plus légers.
- 2.il est possible que tout ceci, depuis le départ et jusqu’à la mise en ligne de la présente divagation, soit un mauvais rêve, venu me visiter en plein black friday. Comment prouver le contraire ?
- Anthony Galluzo, La fabrique du consommateur, Paris, La Découverte, 2023 [2020], p. 15
↩︎ - Cath Oberholtzer, « The Reinvention of Tradition and Marketing of Cultural Values », en ligne [https://cas-sca.journals.uvic.ca/index.php/anthropologica/article/download/2014/1790/3006]. « En tant que marchandise, les capteurs de rêves remplissent les conditions de base de l’art-souvenir : petits, transportables, non périssables, mais aussi faits main et vendus à des prix abordables. En outre, on leur reconnait une utilité, dans la mesure où on peut les porter, s’en servir comme bijou, les utiliser comme une source de bien-être potentiel, pour protéger le conducteur d’un véhicule, pour défendre un ordinateur contre les virus : ↩︎
- Marie Serre, Tourisme et renouveau culturel autochtones : le capteur de rêves dans la communauté huronne-wendat de Wendake, Université du Québec à Trois-Rivières, 2011, en ligne [https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2306/]
↩︎ - Angela Glasker, « Borrowed Meanings: Case Studies of Katsina and
Dreamcatcher Traditions », Honors Projects.
Paper 14; en ligne [https://digitalcommons.iwu.edu/socanth_honproj/14/] ↩︎


Laisser un commentaire